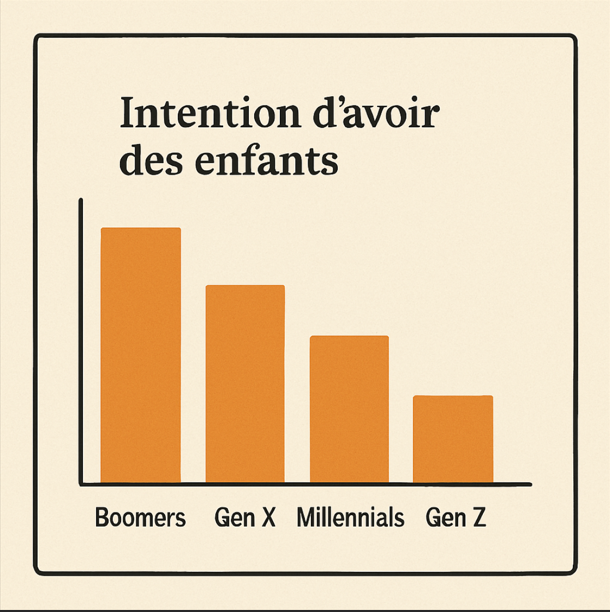Une étude menée par Toluna Harris Interactive pour le Haut Conseil de la famille auprès de 2 039 personnes âgées de 20 à 35 ans éclaire les motivations et réticences de cette génération vis-à-vis de la parentalité. Alors que la France enregistre 1,62 enfant par femme en 2024, contre 1,79 en 2022, comprendre ces dynamiques devient crucial.
Un désir de parentalité majoritaire
Parmi les 20-35 ans interrogés, 39 % sont déjà parents et 44 % pensent le devenir. Au total, 83 % se projettent dans une vie de parents. Seuls 12 % envisagent de ne pas avoir d’enfants.
La trentaine marque un tournant : à partir de 29-31 ans, les parents deviennent majoritaires. Les femmes ont leur premier enfant plus tôt que les hommes. Chez les femmes sans enfant de 32-35 ans, le décrochage est marqué : seulement 48 % se projettent encore comme futures mères, contre 65 % des hommes du même âge.
Les motivations : émotion et transmission avant tout
Pour ceux qui n’ont pas encore d’enfants
Les personnes sans enfant citent massivement cinq motivations principales :
- Avoir des moments de joie et de complicité en famille (85 %)
- Transmettre des valeurs, une éducation, des passions (83 %)
- Donner de l’amour à un enfant et en recevoir (82 %)
- S’occuper d’un enfant, le voir grandir (82 %)
- Rendre sa vie plus belle, plus riche (75 %)
Les motivations centrées sur le couple arrivent ensuite : concrétiser sa vie de couple (66 %), donner un sens à sa vie (61 %).
En revanche, les motivations « par défaut » sont moins citées : faire plaisir à son conjoint (44 %), éviter la solitude (41 %), ou encore contribuer à l’accroissement de la population française (minoritaire).
Pour ceux qui sont déjà parents
Les parents confirment ces motivations a posteriori, avec des scores encore plus élevés (supérieurs à 90 % pour les principales). Une nuance apparaît cependant : ils mettent davantage en avant les dimensions existentielles. 89 % affirment avoir eu un enfant pour rendre leur vie plus belle, et 82 % pour lui donner un sens.
La majorité des parents (68 %) estiment que l’arrivée de leur premier enfant s’est produite au bon moment. Plus de 8 sur 10 se sentaient prêts mentalement.
Les freins : argent, angoisse et liberté
Des obstacles moins cités que les motivations
Les freins à la parentalité sont globalement moins évoqués que les motivations positives. Seuls trois dépassent les 50 % de citations, contre dix pour les motivations.
Le coût financier en tête
Le premier frein cité est l’aspect financier : 62 % des personnes sans enfant estiment que cela coûte trop cher d’élever un enfant. Près d’un sur deux (49 %) considère que les politiques publiques ne soutiennent pas assez les parents.
L’angoisse face au monde
L’état du monde inquiète : 56 % pensent que le monde va trop mal pour accueillir un enfant. 43 % évoquent la surpopulation et les ressources limitées de la planète.
Les peurs personnelles
La peur de la grossesse et de l’accouchement touche 50 % des répondants. 49 % craignent d’avoir un enfant porteur de maladie ou de handicap. Le poids de la responsabilité pèse pour 47 %.
La question de la liberté personnelle
Les raisons individualistes occupent une place importante : 56 % estiment que cela prend trop de temps et d’énergie, 47 % préfèrent se consacrer à leurs loisirs, 46 % souhaitent garder leur liberté.
Un clivage net selon les projets de vie
Ceux qui ne veulent pas d’enfants
Pour les personnes qui n’envisagent pas d’avoir d’enfants, les motivations individualistes dominent largement. 42 % citent la préférence pour les loisirs comme première raison, en dehors de la position de principe elle-même.
Ces personnes expriment des ressentis majoritairement négatifs face à la parentalité (56 %) : angoisse, peur, charge. Seuls 26 % évoquent des aspects positifs. Ils mentionnent aussi davantage les questions d’argent (21 %).
Fait révélateur : seuls 49 % affirment avoir toujours envisagé de ne pas devenir parents. Ce score, inférieur à celui des futurs parents (69 % ont toujours voulu le devenir), traduit un choix plus tardif et probablement une part de contrainte et de résignation.
Ceux qui veulent devenir parents
Les futurs parents se projettent majoritairement à court ou moyen terme : 23 % d’ici 1 à 2 ans, 40 % d’ici 3 à 5 ans. Plus de la moitié (55 %) pensent avoir deux enfants, contre 17 % un seul.
Ils expriment des sentiments positifs (51 %) associés à la parentalité, même si le stress et l’inquiétude sont présents (16 %).
Les façons non traditionnelles de devenir parent intéressent une part notable des répondants : l’adoption (41 %), l’éducation des enfants de son conjoint (37 %), la PMA (35 %). Les femmes se montrent plus ouvertes à ces alternatives.
Avoir un autre enfant : des logiques similaires
Parmi les parents de 20-35 ans, 56 % pensent avoir un ou d’autres enfants. Les motivations restent les mêmes : joie familiale (83 %), amour partagé (83 %), soin et transmission (82 %).
De nouvelles dimensions apparaissent : 71 % veulent mieux profiter de leur rôle grâce à l’expérience acquise, 66 % ne veulent pas que leur enfant soit unique, 56 % souhaitent un enfant d’un autre sexe.
Les freins s’accentuent avec l’expérience
Pour ceux qui ne veulent pas d’autre enfant, le premier motif est de consacrer toute son attention aux enfants existants (58 %).
Mais les contraintes financières pèsent lourd : 52 % estiment que cela coûterait trop cher, 54 % considèrent que les politiques publiques ne les soutiennent pas assez. Cette dernière dimension devient le 2e frein, probablement car l’expérience a permis d’en mesurer les limites.
L’angoisse s’accroît : 54 % craignent davantage l’avenir qu’au moment de leur premier enfant. 51 % jugent que cela prendrait trop de temps et d’énergie.
Les mères mettent particulièrement en avant les questions financières, la peur de l’avenir, et le fait que leur conjoint n’a pas suffisamment participé à la prise en charge des enfants précédents.
Des attentes fortes envers les politiques publiques
Seuls 39 % des 20-35 ans considèrent que les politiques publiques aident suffisamment les parents. Les parents eux-mêmes ne sont pas plus positifs (42 %).
La priorité attendue ? L’amélioration de l’aménagement du temps de travail pour les parents actifs (65 %), particulièrement chez les femmes (72 %). Le renforcement de l’offre de services publics arrive en deuxième position (48 %).
Les aides financières, bien qu’importantes, apparaissent plus secondaires : réduction d’impôts (39 %), augmentation des allocations familiales (38 %).
Responsabilité et accomplissement
De manière spontanée, les 20-35 ans associent fortement la parentalité à la notion de responsabilité (34 %). Mais l’interprétation diffère radicalement selon leur situation.
Chez les parents, cette responsabilité s’accompagne d’évocations positives (64 % : bonheur, amour, joie) et de fatigue (16 %). Chez les futurs parents, les termes négatifs associés sont la peur, le stress et l’inquiétude (16 %).
Devenir parent obtient une note moyenne de 7,2 sur 10 en importance : un score positif mais pas enthousiaste. Seuls 35 % attribuent une note de 9 ou 10.
Cependant, la famille reste le domaine où les jeunes adultes estiment le plus important de s’accomplir (8,5/10), devant la vie amoureuse (8/10), les loisirs (7,9/10) et le travail (7,3/10).
D’autres articles sur la petite enfance et les familles ici.